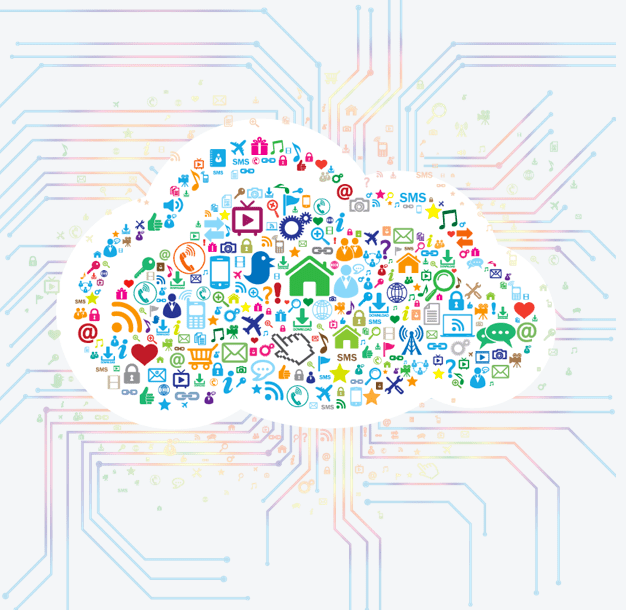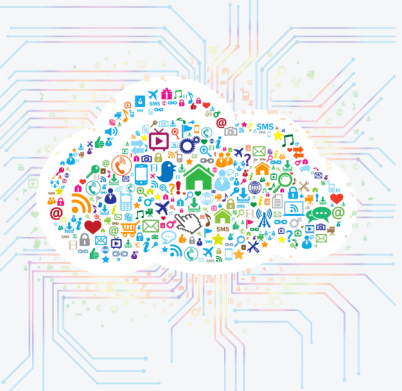C’était l’année de l’éclipse totale du soleil. La plus longue du siècle, en 1973. Une année commune commençant un lundi. Cette année-là Pinochet renversa Salvador Allende. Des femmes manifestaient pour le droit à l’avortement. Et Ilon Specht refusait d’écrire un énième spot pour plaire aux hommes. Ça donnera « Parce que je le vaux bien » et ça collera à l’image planétaire de L’Oréal. Un coup de pub de génie. Et le formidable étendard de toute une génération. C’était il y a plus de quarante ans. Et rayant d’un trait le slogan ringard et sexiste du concurrent Clairol : Does she or doesn’t she ? (le fait-elle, ou pas ?). En 2011, le slogan se mue en « Parce que nous le valons bien ».
Et si le slogan de la pépite française, numéro un mondial de l’industrie cosmétique, était entrain de devenir la promesse de tout un pays ? Le pays balloté entre pessimisme et optimiste décrié par certains est entrain de laisser sa place au pays du sourire. La reprise est là (merci François Hollande) et les touristes sont de retour (merci Bernard Cazeneuve). La société du bonheur privé et du malheur public chère à Jean Viard (Nouveau portrait de la France) demeure peut-être, mais Marcel Gauchet a trouvé la solution (Comprendre le malheur français) en nous amenant à accepter l’ordre des choses : la France ne sera plus jamais une grande puissance et plutôt de le regretter, il vaut mieux ranimer la flamme de notre liberté d’esprit et de notre capacité d’imagination.
Le passé n’est pas meilleur que le présent comme le démontre savoureusement Woody Allen dans Minuit à Paris (2011) alors que Gil, l’écrivain américain en herbe, est transporté par une vieille voiture dans les années 1920, les années folles, qu’il se met à adorer en fréquentant Picasso et Hemingway, Adriana, qui appartient à cette époque et dont il tombe amoureux, se laisse fasciner par les années 1860, Claude Monet, Auguste Renoir et Edgar Degas, à la suite d’un voyage en calèche. Bref, chacun à sa manière rêve du temps passé…
Le monde va mieux, contrairement à ce que l’on entend çà et là dans les médias. Steven Pinker, avec La Part d’ange en nous (2011 et traduit en France en 2017), démontre que, malgré le terrorisme, malgré les conflits contemporains, la violence n’a cessé de diminuer dans le monde au cours des siècles. Nous sommes devenus altruistes ! C’est un fait. Avec son nouvel opus (2018) (Enlightenment Now, non traduit), le psychologue nous dit que nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Alors faisons-le !
Grâce au supplément Week-end d’Aujourd’hui en France, daté du 14 février, ça ne s’invente pas, nous apprenons que :
- les abeilles vont mieux (aux Etats-Unis) ;
- le trou de la couche d’ozone se résorbe lentement mais surement ;
- l’espérance de vie mondiale est à son zénith ;
- les homicides baissent ;
Il est grand temps de relire le petit opuscule rouge électrique d’Edgar Morin (2014) dont le titre est suffisamment évocateur pour vous mettre sur la voie : Enseigner à vivre, manifeste pour changer l’éducation. Il s’agit de permettre à chacun de s’épanouir individuellement et de vivre solidairement.
Ne sommes-nous pas porteur de la fameuse expression française : rire dans sa barbe. C’est-à-dire que nous rions de manière discrète, telle une envie de rire sans en rien laisser paraître. Une satisfaction maligne en quelque sorte. Nous savons rire tout doucement en repensant à quelque chose de passé.
Je vous conseille cet exercice qui consiste non pas à la nostalgie, mais plutôt à se souvenir pour vivre l’instant présent. Pour moi, ce sont ces deux musiciens qui, sur la place de la Comédie à Montpellier, interprètent une chanson des Cranberries en mode instrumental à l’aide d’une guitare et d’un djembé. C’était fin février et je venais de quitter mes étudiants de l’ISCOM, j’étais en vacances et un soleil de printemps irradiait le blanc-gris-bleu des pierres de marbre. Au lieu de traverser la place, j’ai pris le temps. Écouter, regarder, sentir et laisser libre court à mon imagination… Et ça tombe plutôt bien, les musiciens ont rejoué le même morceau samedi.
Il s’agit tout bonnement de donner de l’importance à des choses qui sont en apparences anodines et qui font notre quotidien : sourire aux passantes et aux passants, prendre des nouvelles de ceux que nous aimons, allumer des bougies comme le font les danois ou se sentir bien chez soi dans un cadre intimiste (lire les livres de Meik Wiking, en particulier le livre du Hygge et le livre du Lykke).
J’attrape un livre dans une librairie à Toulouse. Hâte-toi lentement. C’est son titre. L’auteur Lamberto Maffei nous invite à redécouvrir les potentialités et les avantages d’une civilisation pratiquant la réflexion, basée notamment sur le langage et sur l’écriture, et à redonner la priorité au temps du cerveau plutôt qu’à celui des machines. Oublier le dernier tweet, le SMS d’il y a quelques secondes et même le dernier like de ma photo sur Facebook. Après tout quelle importance ?
Se souvenir du dernier livre lu, Légende d’un dormeur éveillé de Gaëlle Nohant et sourire au poète Robert Desnos. Ouvrir son cœur comme le recommande Spirit. Découvrir la magie des coïncidences. Mais surtout réaliser ses rêves. Préparer sa journée de sommeil la journée. Et plus que tout faire confiance à ses intuitions, se fier à son nez, loin de cette société des écrans qui brouille toute perception juste et de ces algorithmes qui veulent capter notre attention et nous enfermer dans un monde où notre temps de cerveau disponible se vend aux enchères.
Le journaliste québécois Jean-Benoît Nadeau, auteur d’un livre sur la société française (The Bonjour Effect, publié en 2016 avec Julie Barlow) ne dit-il pas qu’il s’est émerveillé face aux performances des trains français ou à la qualité des menus de nos cantines…
C’est un été français comme le chante Nicola Sirkis.